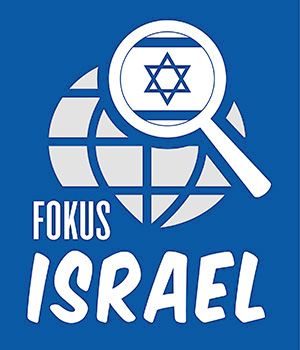Sionisme – la nécessité d’un État juif distinct
Affirmation
Le sionisme est un mouvement politique juif réactionnaire et colonialiste.

Les faits
Le sionisme moderne est un mouvement juif qui a débuté à la fin du XIXe siècle dans le but de créer un État pour les Juifs. Le contexte était la montée de l’antisémitisme en Europe depuis le milieu du 19e siècle et les persécutions des Juifs en Russie tsariste. Celles-ci ont conduit à un changement de mentalité chez des intellectuels juifs de premier plan comme le médecin Leo Pinsker et, peu après, le journaliste et écrivain Theodor Herzl. Auparavant, ils s’étaient prononcés en faveur de l’assimilation des Juifs dans leurs pays respectifs. Ils reconnaissaient désormais que les Juifs ne seraient à l’abri de la persécution que dans un État distinct. Ils ont rapidement compris que cet État devait être situé dans ce qui était alors la Palestine, car c’est là que les Juifs avaient toujours vécu. Les Juifs qui ont fondé l’État d’Israël n’étaient donc pas des colonialistes, mais des rapatriés.
L’un des premiers grands partisans d’un État-nation juif fut le médecin Leo Pinsker, qui vivait à Odessa. Celui-ci s’était d’abord prononcé en faveur de l’assimilation des Juifs dans leur environnement respectif. Mais après les pogroms de 1881 en Russie et après avoir constaté un antisémitisme rampant en Europe occidentale, Pinsker changea radicalement d’avis.
Dans son livre de 1882 « Autoemancipation ! Exhortation à ses compagnons de tribu par un Juif russe », Pinsker a réclamé un pays à part entière pour les Juifs. Il est ainsi devenu le premier précurseur important du sionisme moderne, c’est-à-dire le mouvement politique qui vise à créer un État juif indépendant.
Cependant, Pinsker n’a pas été très bien accueilli par les Juifs d’Europe occidentale (assimilés) et les Juifs orthodoxes.
L’homme qui est aujourd’hui considéré comme le principal précurseur du mouvement sioniste, le journaliste et écrivain viennois Theodor Herzl, a connu une situation similaire. Herzl était lui aussi parvenu à la conclusion que seul un État séparé offrirait aux Juifs une protection contre l’antisémitisme et les persécutions.
L’« affaire Dreyfus » en France a donné une impulsion importante à ce sujet. Il s’agissait d’un scandale judiciaire dans les années 1890 en France, qui s’accompagnait d’une haine antisémite massive. Il s’agissait d’accusations infondées de haute trahison contre le capitaine d’artillerie juif Alfred Dreyfus, qui servait dans l’armée française. (voir « L’affaire Dreyfus »).

« L’État juif » et 1er Congrès sioniste de Bâle
C’est dans ce contexte qu’Herzl, qui travaillait alors comme correspondant à Paris, a publié en 1896 son livre « L’État juif – Essai de solution moderne de la question juive ». Il y expliquait pourquoi un État juif était nécessaire : d’une part à cause de l’antisémitisme, et d’autre part parce que, dans le sillage des Lumières, l’importance de la religion en tant qu’élément de cohésion avait largement disparu.
Dans « L’État juif », Herzl aborde également en détail les aspects très pragmatiques de la création d’un État juif. Il s’agissait notamment de savoir où cet État devait être situé (en Argentine ou en Palestine), quel type d’organisation devait acheter les terres nécessaires et combien de ressources financières étaient nécessaires. Il s’est également penché sur la forme de gouvernement appropriée (république aristocratique) et sur la question de la religion (séparation claire de la religion et de l’État). Il en va de même pour la langue nationale (Herzl exclut l’hébreu, car trop peu de Juifs le maîtrisent, et plaide pour l’allemand).
Au moins dans les milieux juifs, le livre de Herzl fut, selon les termes actuels, un best-seller. Il a conduit à la tenue du premier congrès sioniste à Bâle l’année suivante, du 29 au 31 août 1897. Les 204 délégués y adoptèrent ce que l’on appelle le « programme de Bâle », dans lequel ils déclarèrent : « Le sionisme aspire à la création d’un foyer en Palestine, garanti par le droit public, pour les Juifs qui ne peuvent ou ne veulent pas s’assimiler ailleurs ».
Afin d’accélérer la création de l’État, les délégués réunis à Bâle fondèrent l’Organisation sioniste mondiale (OMS) et nommèrent Theodor Herzl à sa présidence.
L’Organisation sioniste mondiale
La WZO s’est immédiatement mobilisée. L’un de ses premiers objectifs était de s’implanter dans le plus grand nombre possible de communautés juives. Les différents courants du sionisme comprenaient certes des sionistes religieux, en plus des socialistes et de ceux qui mettaient l’accent sur la préservation de la culture juive, mais les juifs orthodoxes, en particulier en Allemagne, étaient (et sont encore en partie) opposés à l’idée d’un État juif mis en œuvre par des forces laïques ; c’est pourquoi ils n’ont pas participé au premier congrès sioniste à Bâle.
En vue de l’achat de terres en Palestine, l’OMD a également créé le Jewish Colonial Trust (l’actuelle Bank Leumi) et a désigné un comité d’action chargé de contrôler le Trust. Le Fonds national juif JNF/Keren Kajemeth a également été créé plus tard pour réunir les fonds nécessaires à l’achat de terres. Celui-ci a immédiatement commencé à mettre en œuvre sa mission.
De son côté, Herzl a tenté de convaincre les principaux chefs d’État européens de l’idée d’un État juif. Pour ce faire, il a rencontré l’empereur allemand Guillaume II à Constantinople (Istanbul) et à Jérusalem. En 1901, il a rencontré le sultan Abdülhamid II, le souverain de l’Empire ottoman, dont la Palestine faisait alors partie. Ces rencontres n’ont pas permis à l’OMD d’obtenir des résultats tangibles, mais elles ont accru sa notoriété et sa crédibilité. Pour la même raison, c’est-à-dire pour attirer l’attention du public britannique et des politiciens du Royaume-Uni, l’OMD a tenu son 4e Congrès sioniste en août 1900 à Londres plutôt qu’à Bâle.
Déclaration Balfour et plan de partage de l’ONU
Il a fallu près de vingt ans pour que l’engagement de l’OMD en Grande-Bretagne porte ses fruits. Pendant la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne avait conquis la Palestine sur l’Empire ottoman. Deux ans plus tard, en 1917, le ministre britannique des Affaires étrangères de l’époque, Arthur James Balfour, a déclaré dans ce qui est devenu depuis la « Déclaration Balfour » : « Le gouvernement de Sa Majesté considère avec bienveillance l’établissement d’un foyer national pour le peuple juif en Palestine et fera de son mieux pour faciliter la réalisation de cet objectif ».
Il a fallu encore vingt ans pour que cette déclaration d’intention devienne une décision ferme : Le 29 novembre 1947, sous le coup de l’assassinat de six millions de Juifs pendant l’Holocauste , l’ONU a dit oui à la partition de la Palestine en un État palestinien et un État juif.
Theodor Herzl n’a pas vécu pour voir cela, ni la proclamation de l’État d’Israël l’année suivante : il est mort d’un arrêt cardiaque en 1904. Après la clôture du premier congrès sioniste à Bâle en 1897, Herzl avait écrit dans son journal : « Si je résume le congrès de Bâle en un mot – que je me garderai bien de prononcer publiquement – c’est celui-ci : à Bâle, j’ai fondé l’État juif. Si je le disais aujourd’hui à haute voix, un rire universel me répondrait. Peut-être dans cinq ans, en tout cas dans cinquante ans, tout le monde le reconnaîtra ».
Son pronostic s’est avéré exact à l’année près.
Lecture recommandée par la rédaction : L’État d’Israël