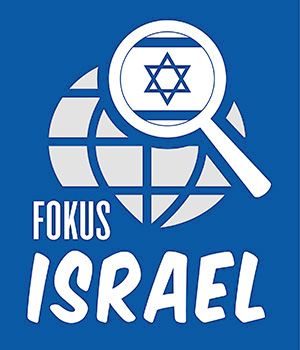La question des colonies et la solution des deux États
Affirmation
La construction de colonies juives en Cisjordanie est responsable de l’absence de paix entre les Palestiniens et Israël.

Les faits
Les colonies juives construites en Cisjordanie et à Jérusalem-Est au cours des cinquante dernières années sont illégales au regard du droit international et constituent un obstacle à une résolution pacifique du conflit entre Palestiniens et Israéliens. Mais elles n’en sont pas la cause. L’origine du conflit réside dans le refus des États arabes de reconnaître le modèle de solution à deux États (avec un État juif et un État palestinien) proposé par l’ONU.
Ce refus remonte à 1947, l’année où l’ONU a adopté le plan de partage. En revanche, les premières colonies juives en Cisjordanie n’ont été établies que plus de vingt ans plus tard, après qu’Israël eut conquis ce territoire sur la Jordanie lors de la guerre des Six Jours de 1967, ainsi que la bande de Gaza sur l’Egypte.
Gaza montre que le renoncement aux colonies n’apporte pas nécessairement la paix : Israël y a évacué ses propres colonies dès 2005 et s’est retiré complètement de la bande de Gaza. Mais depuis, l’État hébreu est confronté à des attaques incessantes des organisations terroristes Hamas et Jihad islamique au pouvoir à Gaza, jusqu’au massacre du 7 octobre 2023.
Immédiatement après sa victoire dans la guerre des Six Jours en juin 1967, Israël a commencé à construire des colonies en Cisjordanie (ainsi que sur les hauteurs du Golan conquises par la Syrie), anciennement occupée par la Jordanie. Celles-ci se trouvaient au-delà de la « ligne verte », qui avait été convenue comme frontière dans l’armistice avec la Jordanie.
Raisons militaires, politiques et économiques
Pour Israël, ces premières colonies avaient avant tout des raisons stratégiques de sécurité : Elles devaient sécuriser le territoire national en cas de nouvelle guerre. Elles étaient donc situées près de la frontière.
Au cours des années et des décennies suivantes, la colonisation s’est étendue à des parties de plus en plus grandes de la Cisjordanie, et des colons juifs se sont également installés dans la partie orientale de Jérusalem, conquise par les Jordaniens. Il en résulte qu’aujourd’hui, selon les derniers recensements, 450 000 colons vivent en Cisjordanie en plus des 2,5 millions de Palestiniens. A Jérusalem-Est, 435’000 Palestiniens et 220’000 Juifs vivent.
Lors de la construction des premières colonies, les raisons militaires et de sécurité ont joué un rôle primordial. Les colonies construites par la suite et celles d’aujourd’hui ont été et sont encore principalement motivées par des considérations religieuses, économiques et politiques. Au fil des années, de plus en plus de colons orthodoxes se sont installés en Cisjordanie, qui est la Judée et la Samarie bibliques, deux foyers traditionnels des Juifs.
Les aspects religieux ont également joué un rôle prépondérant dans la (re)colonisation d’Hébron, qui a eu lieu dès 1968. C’est en effet à Hébron que se trouve le tombeau d’Abraham. Jusqu’au pogrom de 1929, au cours duquel plus de 100 Juifs ont été assassinés et les autres ont dû fuir, des Juifs ont toujours vécu dans cette ville construite en 300 av.
Outre les raisons religieuses, des considérations économiques jouent souvent un rôle dans la décision des Israéliens de s’installer en Cisjordanie. En effet, les logements y sont subventionnés et donc nettement moins chers qu’en Israël même.
Mais ce sont avant tout des considérations politiques qui ont poussé les gouvernements israéliens, notamment ceux de droite, à approuver de nombreux projets de colonisation au cours des dernières décennies.
La multiplication des nouvelles colonies et des projets de construction de colonies en suspens vise à créer des faits accomplis afin de rendre impossible la solution à deux États décidée par l’ONU en 1947. Et ce, bien que la solution à deux Etats ait été approuvée par Israël à l’époque et plus tard, notamment dans le cadre du processus de paix d’Oslo avec l’OLP, entamé en 1993.
Des affrontements violents, souvent mortels, opposent donc régulièrement les Palestiniens vivant en Cisjordanie aux colons juifs. Alors qu’auparavant, ces attaques étaient le plus souvent le fait des Palestiniens, on assiste depuis peu à une recrudescence des attaques de colons ultranationalistes et religieux contre la population palestinienne de Cisjordanie.
La situation juridique est controversée
La situation juridique des colonies juives en Cisjordanie est controversée. L’ONU, l’Union européenne et la Cour internationale de justice considèrent la construction de colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est comme illégale et l’ont condamnée par le passé dans différentes résolutions et décisions.
La raison invoquée est la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre de 1949, dont l’article 49/paragraphe 6 stipule que « la puissance occupante ne pourra pas déporter ou déplacer une partie de sa propre population civile dans le territoire qu’elle occupe ».
Le gouvernement israélien a une vision différente de la situation et affirme, sur la base d’une expertise qu’il a commandée (« rapport Levy » de 2012), que cet article de la Convention de Genève ne s’applique pas dans le cas présent, car la Cisjordanie et Jérusalem-Est ne sont pas des « territoires occupés ». Ce point de vue n’est cependant pas partagé au niveau international.
La Cour suprême israélienne ne défend pas non plus sans réserve la position du gouvernement israélien. Par le passé, la Cour suprême ne s’est pas opposée par principe à la construction de colonies en Cisjordanie. Cependant, elle a régulièrement déclaré illégaux des projets de colonisation et des expropriations de propriétaires terriens palestiniens approuvés par le gouvernement.
Dr Einat Wilf, ancien membre de la Knesset, à l’émission « Israel Weekly » d’ILTV, sur la question de savoir si les colonies israéliennes empêchent une solution à deux États.
Un obstacle sur la voie de la solution à deux États
Comme le souhaitent principalement les politiciens israéliens ultranationalistes et religieux, le grand nombre de colonies existantes, qui comptent près d’un demi-million d’habitants juifs, constitue un obstacle majeur à la création d’un État palestinien englobant la Cisjordanie et Gaza, comme le prévoit la solution à deux États de 1947.
Dans le passé, il y a eu plusieurs tentatives de mettre en œuvre cette solution malgré tout. En 2000/2001, des négociations de paix ont eu lieu entre l’OLP et Israël sous le patronage du président américain Bill Clinton. Le gouvernement israélien a accepté une proposition d’État palestinien indépendant qui aurait englobé l’ensemble de Gaza et 94 à 96 % du territoire de la Cisjordanie.
Selon le plan de paix, jusqu’à trois pour cent du territoire manquant aurait été compensé par Israël par la cession de son propre territoire. Cela aurait permis de créer un pont terrestre entre Gaza, située au bord de la Méditerranée, et la Cisjordanie, située à l’intérieur des terres. L’État palestinien aurait ainsi formé une unité territoriale. Mais le président palestinien de l’époque, Yasser Arafat, a rejeté la proposition.
En 2008, une autre tentative de mise en œuvre de la solution à deux États, malgré le problème des colons, a échoué. Le Premier ministre israélien de l’époque, Ehud Olmert, a présenté un plan qui prévoyait que les Palestiniens cèdent 6,3% de leur territoire à Israël. Cela aurait permis d’intégrer 80% des colons juifs au territoire central israélien. Les Israéliens s’étaient déjà retirés de Gaza en 2005 et avaient évacué toutes leurs colonies.
En contrepartie, les Palestiniens devaient recevoir 5,8% du territoire israélien. Et comme l’avaient déjà proposé le président américain Clinton et le Premier ministre israélien de l’époque, Ehud Barak, en 2001, un pont terrestre devait permettre de créer un État d’un seul tenant entre Gaza et la Cisjordanie. Mais le successeur d’Arafat à la présidence palestinienne, Mahmoud Abbas, a également rejeté le plan de paix israélien.
Comme environ 80% des colons israéliens vivant aujourd’hui en Cisjordanie sont concentrés dans cinq grands blocs, les experts pensent qu’une solution à deux États est toujours possible. La guerre actuelle à Gaza a conduit les Etats-Unis et l’Union européenne à faire à nouveau fermement pression en faveur d’une telle solution.
Vœux pieux et réalité
Dans la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) du 27 janvier 2024, Peter Rasonyi, chef de la section étrangère, écrit à ce sujet : « Les États-Unis et l’UE exigent un État palestinien. Ils sont ainsi du bon côté de la morale et du mauvais côté de la réalité ».
En exigeant la mise en œuvre immédiate de la solution à deux Etats, l’Europe et les Etats-Unis ignorent les réalités politiques du Proche-Orient, critique Rasonyi. Si les Etats-Unis et l’UE prennent au sérieux leur demande d’un Etat palestinien indépendant, ils doivent d’abord créer les conditions nécessaires à cet effet.
Cela signifie en premier lieu qu’ils doivent veiller à la sécurité d’Israël, écrit le chef du service étranger de la NZZ. Car ce n’est que si celle-ci est garantie qu’Israël pourra être convaincu de renoncer à son contrôle sur les territoires palestiniens. « Une création forcée d’un Etat palestinien contre la volonté d’Israël, comme l’a suggéré Borrell (le vice-président de la Commission européenne en charge de la politique étrangère et de sécurité, réd.), est totalement aberrante ».