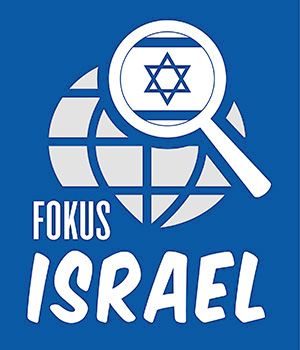En Israël aussi, tous les juifs ne se valent pas
La décision de partage de l’ONU de 1947 définit Israël comme un État pour les Juifs. Et dans la déclaration d’indépendance israélienne, par laquelle David Ben Gourion a proclamé l’État d’Israël le 14 mai 1948, le judaïsme occupe une place centrale.

Ce n’est pas aussi évident qu’il pourrait y paraître. En effet, le sionisme moderne, né au XIXe siècle et force motrice pour la création d’un État juif indépendant, était un mouvement laïc. Il y avait certes des sionistes religieux. Mais Theodor Herzl, le père du sionisme moderne, et la majorité des délégués aux congrès sionistes qui, à partir de 1897, ont œuvré à la création d’un État juif indépendant en Palestine, étaient des Juifs très laïques.
Cela n’a pas changé jusqu’à aujourd’hui. Selon le bureau israélien des statistiques, 7,1 millions de Juifs vivaient en Israël fin 2022[i]. Selon leur propre évaluation, il s’agit de :
49% laïc
29% traditionnel
13% orthodoxe moderne
9% ultra-orthodoxe (hared).
C’est ce que révèle un sondage réalisé par l’institut de sondage américain Pew Research Center. L’enquête date de 2014/2015 et est donc plus ancienne que les dernières données statistiques officielles sur la population. Mais le message principal de l’enquête est toujours valable.

Conflits programmés
La différence d’importance que revêt la religion pour les juifs laïcs et traditionnels (78% au total) d’une part, et l’importance de la religion pour les juifs orthodoxes modernes et ultra-orthodoxes (22% au total) d’autre part, est source de conflits potentiels, tant dans la vie quotidienne que dans la politique.
Cela commence par la réglementation des transports publics qui, dans la plupart des endroits d’Israël, ne fonctionnent pas le jour du shabbat (c’est-à-dire du vendredi soir au samedi soir), car la conduite est interdite par la loi religieuse juive. Et cela va jusqu’à la question de savoir si les juifs orthodoxes peuvent être contraints de faire leur service militaire contre leur gré.
La Cour suprême israélienne a rendu en 2017 une décision de principe en ce sens. Elle a donc demandé au gouvernement et au parlement de modifier une disposition datant de la création de l’État et qui exemptait les juifs orthodoxes du service militaire. Cette décision de justice a provoqué à l’époque des protestations massives dans la partie orthodoxe de la population et des débats au Parlement. Néanmoins, il y avait toujours des Juifs orthodoxes qui s’engageaient dans le service militaire. Ils se faisaient remarquer par leur volonté de se battre, mais étaient doublement isolés : dans l’armée en raison de leur radicalisme, dans leur propre communauté parce qu’ils violaient des commandements et créaient un précédent désagréable. Après l’attaque terroriste dévastatrice du Hamas le 7 octobre 2023, plus de 2 000 juifs orthodoxes se sont portés volontaires pour le service militaire.
La division entre les juifs laïques et traditionnels d’une part, et les juifs orthodoxes modernes et ultra-orthodoxes d’autre part, est également un sujet récurrent en politique. Il s’agit également de décider si les lois de l’État doivent suivre les prescriptions religieuses, ce que les juifs orthodoxes préconisent. Ou si elles doivent rester fondamentalement laïques, comme c’est désormais le cas par analogie avec d’autres démocraties occidentales – et comme le demandent les milieux juifs laïques et traditionnels.
Faire pencher la balance
Les juifs orthodoxes et ultra-orthodoxes ne représentent certes ensemble qu’environ 20% de la population juive et même seulement 15% de la population totale d’Israël. Mais ils ont un poids politique disproportionné. Cela est lié au système électoral israélien. En effet, lors des élections au Parlement israélien, la Knesset, la barre pour les partis n’est que de 3,4%.
Il en résulte une forte fragmentation des forces politiques. En conséquence, même les petits partis orthodoxes et ultra-orthodoxes font souvent pencher la balance lorsqu’il s’agit de former une coalition gouvernementale. Grâce à cette position, les partis juifs orthodoxes et ultra-orthodoxes sont toujours en mesure d’imposer des concessions politiques. Bien qu’Israël soit un État laïc, la religion joue un rôle beaucoup plus important dans la politique israélienne que dans d’autres démocraties occidentales.
Lecture recommandée par la rédaction
L’importance de la religion dans l’État d’Israël | Israël | bpb.de
[i] Au total, la population résidente israélienne s’élevait à 9,65 millions à la fin de l’année 2022, selon le bureau des statistiques. Parmi eux, 7,1 millions étaient juifs, 2,03 millions étaient arabes et 0,51 million appartenaient à un autre groupe de population.