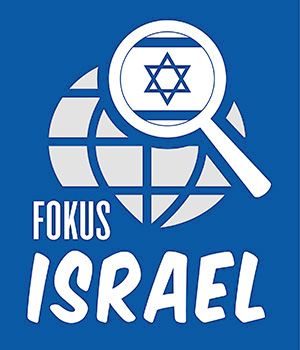Débat sur les images de famine à Gaza : quand des cas individuels tragiques deviennent des armes
Une photo choquante d’un petit garçon squelettique d’à peine deux ans dans les bras de sa mère s’est répandue dans le monde entier ces derniers jours. Les médias de référence tels que la BBC, le New York Times, The Guardian et Al Jazeera ont présenté Muhammad Zakariya Ayyoub al Matouq (18 mois) comme le symbole d’une famine prétendument provoquée par Israël à Gaza. Peu de temps après, une deuxième image a fait le tour du monde : celle d’Osama al Rakab, âgé de cinq ans et tout aussi émacié, était censée prouver qu’Israël affamait systématiquement les enfants.
Le Centre de coordination de l’aide humanitaire d’Israël (COGAT) a rejeté ces deux images et a publié pour la première fois des faits médicaux détaillés qui n’avaient jusqu’alors guère été pris en compte.
Deux enfants, deux maladies rares
- Muhammad al Matouq (18 mois)
Un rapport établi à Gaza (mai 2025) fait état d’une paralysie cérébrale, d’une hypoxémie chronique et d’un trouble musculaire génétique rare. Cette combinaison provoque une atrophie musculaire et un poids insuffisant, indépendamment de l’apport alimentaire. La mère de Muhammad a expliqué à CNN que son fils avait besoin d’une alimentation spéciale et d’une kinésithérapie, peu disponibles en temps de guerre. - Osama al Rakab (5 ans)
Selon le COGAT, Osama souffre d’une grave maladie génétique du métabolisme. Israël a coordonné dès le 12 juin son départ pour l’Italie, où il est actuellement soigné. Selon le COGAT, la faim n’est pas un problème.
Les deux cas ont d’abord été diffusés sans ce contexte. Ce n’est qu’après des recherches menées par le chien de garde HonestReporting et le journaliste britannique David Collier que les diagnostics ont été rendus publics.
« Les images tragiques émeuvent, mais peuvent aussi mentir »
« Les images tragiques émeuvent fortement, à juste titre, mais lorsqu’elles sont utilisées pour mentir et répandre la haine, elles font plus de mal que de bien », a souligné dimanche un porte-parole du COGAT. L’ambassadeur adjoint d’Israël en Australie, Amir Meron, a même parlé d’une « déformation de type campagne ».
Sur les réseaux sociaux en particulier, les photos ont été rapidement partagées comme preuve présumée d’un affamement ciblé – sans vérification des dossiers médicaux ou des sources des images. Alors que l’agence turque Anadolu a diffusé la photo de Mohammed, l’origine de celle d’Oussama n’est pas claire.
Aide humanitaire et guerre de propagande
Israël rappelle que depuis le début de la guerre, plus de 94 000 convois d’aide ont été autorisés à entrer dans la bande de Gaza. Des cessez-le-feu tactiques et plusieurs corridors humanitaires ont été mis en place quotidiennement. Depuis juillet, des pays tiers sont autorisés à parachuter de l’aide humanitaire ; lors de la première mission conjointe de la Jordanie et des Émirats arabes unis, environ 25 tonnes de fournitures ont atterri.
Israël tient le Hamas pour responsable du fait que les livraisons ne parviennent souvent pas aux personnes dans le besoin. L’organisation contrôlerait des dépôts, détournerait des marchandises ou approvisionnerait de préférence ses propres combattants. Il est difficile d’obtenir des confirmations indépendantes, mais les organisations humanitaires occidentales et arabes font également état de vols de stocks.
Au 22 juillet, environ 950 chargements de camions n’avaient pas été distribués dans la bande de Gaza, selon le COGAT. Depuis le 27 juillet, les agences de l’ONU ont récupéré un peu plus de 120 de ces camions, selon la COGAT, et 180 autres sont arrivés en même temps. Cela signifie qu’environ 800 à 900 véhicules attendent toujours d’être collectés.
Les médias face à leurs responsabilités
Cette affaire soulève à nouveau la question de la manière dont les rédactions traitent les images émotionnellement chargées provenant de zones de conflit. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a dénoncé une « catastrophe humanitaire » en citant Muhammad al Matouq. Les spécialistes de l’éthique des médias demandent au contraire
- Le contexte avant les clics – Sans contexte médical, la présentation peut être trompeuse.
- Vérifier la source – Qui a pris la photo et quel est l’agenda de la source ?
- Demander une contre-expertise – Les autorités telles que COGAT ou les hôpitaux locaux fournissent également des documents exploitables.
Pour Joe Hyams, directeur de HonestReporting, ce remue-ménage montre « le pouvoir d’une photo unique pour orienter les débats dans une direction, qu’elle résiste ou non aux faits ».
Une leçon de guerre des images numériques
Les destins de Muhammad et d’Osama sont tragiques et leurs souffrances bien réelles. Pourtant, leurs photos ne peuvent guère être considérées comme des preuves d’une politique de famine systématique. Elles révèlent plutôt les pièges d’un écosystème médiatique qui accorde souvent plus d’importance à l’indignation rapide qu’à la vérification minutieuse. Que ce soit pour les critiques d’Israël ou pour les défenseurs de sa guerre, ces cas rappellent qu’à l’ère du numérique, chaque image peut avoir un impact mondial en quelques minutes – et être tout aussi rapidement mal interprétée. Si l’on veut assumer la responsabilité du discours public, il faut donc plus que jamais laisser parler les faits avant les images.
Lisez aussi ici : L’aide humanitaire parvient à la population malgré le Hamas
Vous avez rencontré un problème ?