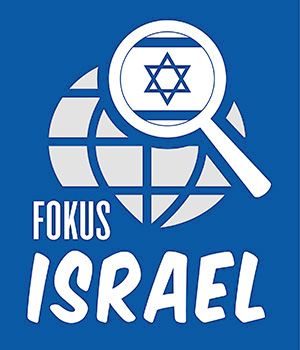10 enseignements tirés du 7 octobre et de la période qui a suivi
Par Sacha Wigdorovits
Une semaine mouvementée s’achève pour Israël. Mardi a marqué le deuxième anniversaire du massacre du 7 octobre 2023, au cours duquel plus de 1 200 civils israéliens, citoyens d’autres pays et membres de l’armée et de la police israéliennes ont été assassinés par des terroristes palestiniens et 251 autres ont été pris en otage.
Deux jours plus tard seulement, le jeudi 9 octobre, la nouvelle salvatrice, que l’on croyait impossible jusqu’à récemment, a suivi : Israël et le Hamas sont parvenus à un accord sur la première phase du plan de paix en 20 points pour Gaza proposé par le président américain Donald Trump. La guerre est terminée.
Cela signifie que les 48 otages du 7 octobre encore détenus par le Hamas retourneront en Israël dans les prochains jours. Vingt d’entre eux seraient encore en vie.
Ces deux événements – l’anniversaire du plus grand pogrom de l’histoire de l’après-guerre et la nouvelle du retour imminent des derniers otages enlevés par le Hamas – ont été empreints d’émotion, mais il est également temps de réfléchir aux enseignements que nous pouvons tirer de ces deux dernières années. Par exemple, les suivants :
- L’arrogance est mortelle. On ne sait pas encore comment un massacre d’une telle ampleur a pu se produire le 7 octobre 2023 dans le sud d’Israël. Mais on peut d’ores et déjà affirmer que le gouvernement israélien – et avec lui le commandement militaire et les hauts responsables des services de renseignement – a échoué.
Le gouvernement avait négligé la sécurité à la frontière sud au profit des colonies de Cisjordanie. C’est là que vivent 900 000 Israéliens, qui comptent parmi les électeurs les plus fidèles de l’actuel gouvernement d’extrême droite. En ce qui concerne le Hamas, au pouvoir à Gaza, le gouvernement s’est bercé d’une fausse sécurité en permettant au Qatar de financer l’organisation terroriste pendant des années.
C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles, dans les jours précédant le 7 octobre, le gouvernement a ignoré les avertissements des soldats stationnés à la frontière et des services de renseignement concernant des activités inhabituelles à Gaza.
De leur côté, les dirigeants de l’armée et les services de renseignement doivent être accusés d’avoir estimé que le Hamas était incapable de planifier et de mener une opération de cette ampleur à l’échelle de l’état-major.
Le 7 octobre, cet échec a non seulement coûté la vie à 1200 personnes, mais aussi la confiance dans l’armée israélienne, Tsahal, et en particulier dans les services de renseignement israéliens, jusque-là très respectés.
Plus tard, ils ont éliminé tour à tour les principaux dirigeants du Hamas, du Hezbollah libanais, de l’armée iranienne, des Gardiens de la révolution et du programme nucléaire, ainsi que du groupe terroriste des Huthi au Yémen, dans des actions spectaculaires.
Certes, l’armée et les services secrets ont ainsi largement réhabilité leur réputation, fortement entachée le 7 octobre 2023. Mais les 1 200 victimes de l’erreur d’appréciation du Hamas à l’époque ne revivront pas et la souffrance de leurs proches ne sera pas atténuée. - Les guerres sont plus longues et plus coûteuses que prévu. En fin de compte, Israël a remporté la victoire sur tous les fronts sur lesquels le pays a dû se battre en raison de l’acte terroriste du 7 octobre. Mais cela ne peut pas masquer le fait que la guerre à Gaza a duré beaucoup plus longtemps et a fait beaucoup plus de victimes que ce qui avait été annoncé au départ.
Si les autres points du plan de paix de Trump sont mis en œuvre dans les mois à venir et que le conflit entre Palestiniens et Israéliens est définitivement réglé, ces sacrifices n’auront au moins pas été vains. - Les changements politiques au Moyen-Orient ne peuvent être obtenus sans recourir à la force militaire. « Contrairement à l’Europe, nous savons que la diplomatie seule ne permet pas toujours d’atteindre les objectifs ». C’est ce qu’a déclaré le nouvel ambassadeur israélien en Suisse, Tibor Schlosser, lors d’un entretien avec FokusIsrael.ch peu après sa prise de fonction.
L’évolution récente confirme cette conclusion. Ce n’est que parce que le gouvernement israélien a poursuivi son offensive militaire contre le Hamas et n’a pas cédé aux pressions internationales et internes à Israël que l’organisation terroriste est désormais prête à négocier un plan de paix qui conduira à son désarmement et à son retrait du pouvoir.
Ce n’est pas tant par conviction personnelle que sous la pression du Qatar, de la Turquie et d’autres pays musulmans. En revanche, l’ONU et les gouvernements occidentaux qui ont voulu faire pression sur Israël en reconnaissant prématurément l’État inexistant de Palestine sont totalement hors sujet dans ce processus – comme dans tout le conflit d’ailleurs. - Le droit international doit être adapté. Dans sa lutte contre le Hamas, Israël a été régulièrement accusé de ne pas respecter le droit international et même de commettre un génocide contre la population palestinienne. D’une part, en raison des attaques contre des installations civiles, d’autre part, parce qu’il a temporairement interdit l’acheminement de l’aide.
Les Conventions de Genève autorisent les deux dans certaines circonstances, précisément dans les cas où Israël a agi de la sorte. C’est pourquoi ces accusations à l’encontre d’Israël sont sans fondement.
L’accusation de génocide qui a été lancée chez nous par la gauche politique est également totalement injustifiée. En effet, jamais une puissance belligérante n’a pris des mesures aussi complètes pour protéger la population civile ennemie que l’armée israélienne (Tsahal) l’a fait à Gaza.
Néanmoins, le droit international établi après la Seconde Guerre mondiale doit être adapté. La guerre d’Israël contre l’Iran en est une illustration.
Les mollahs de Téhéran ont toujours fait de la destruction de l’État juif une raison d’État et ont poussé au développement d’une bombe nucléaire pour cette raison.
Malgré cette annonce claire et le risque de destruction, plusieurs experts en droit international ont déclaré qu’Israël n’aurait pas dû lancer son attaque préventive contre le programme d’armement nucléaire iranien. Selon les experts en droit international concernés, cela n’aurait été autorisé que juste avant une attaque nucléaire iranienne.
En d’autres termes : Israël aurait dû attendre d’avoir peu de chances d’éviter sa propre destruction avant d’attaquer.
Un droit qui exige d’un État et d’un peuple un tel comportement autodestructeur doit être adapté de toute urgence. - Les médias sociaux et traditionnels sont un instrument de guerre hybride.Le conflit à Gaza a également été une guerre de propagande. Les médias sociaux, en particulier, ont joué un rôle crucial dans cette guerre. Ils ont renforcé le Hamas et affaibli Israël.
Pour prouver la prétendue inhumanité de son adversaire, l’organisation terroriste a continuellement fait circuler des informations non vérifiées. En particulier, des chiffres de victimes invérifiables et des images hors contexte, prises par ses propres photographes ou truquées à l’aide de l’intelligence artificielle. Celles-ci ont été diffusées des millions de fois en quelques minutes sur des canaux tels que Facebook, Tiktok, Telegram, X et Instagram.
Cet appel cynique à la compassion et à l’indignation du public en uniforme a d’autant mieux fonctionné qu’il a également « contaminé » de nombreux journalistes. Il en a résulté une couverture du conflit de Gaza dominée par l’émotion plutôt que par les principes artisanaux habituels du journalisme.
Les médias sociaux et de nombreux médias traditionnels ont ainsi préparé le terrain pour les actions de protestation de masse contre l’État juif dans le monde occidental.
Israël a tenté de contrer la propagande trompeuse du Hamas par des explications et des informations factuelles. Mais cela a échoué. Car dans la lutte entre les émotions et les faits, ce sont toujours les émotions qui l’emportent.
D’autre part, en tant qu’État de droit démocratique, Israël ne pouvait pas se permettre de mener une propagande basée sur le mensonge similaire à celle de l’organisation terroriste palestinienne. Les gouvernements démocratiques occidentaux feraient bien d’en tirer les leçons pour leurs propres conflits et leur vulnérabilité dans les médias sociaux. - L’Europe cède à la pression de la rue. Peu après le 7 octobre 2023, les gouvernements européens se sont pratiquement donné le mot lors de leurs visites de solidarité en Israël.
Il n’en reste pas grand-chose. Plus la guerre durait, plus le nombre de victimes augmentait et plus la désinformation qui y était associée par le Hamas, l’ONU et les ONG proches de l’ONU s’intensifiait, plus les marches de protestation dans les rues des métropoles européennes prenaient de l’ampleur. Et plus les gouvernements européens et autres institutions se sont distanciés de l’État juif et l’ont menacé de sanctions.
Pour Israël lui-même, cela n’a guère d’importance sur le plan politique et militaire. Mais cela a probablement confirmé au pays que l’on ne peut pas compter sur l’Europe. - L’Europe continue de méconnaître le danger de l’islam radical. Les manifestations de masse anti-israéliennes et antisémites dans les rues européennes ont généralement été organisées par des militants de gauche et d’extrême gauche.
Mais ces manifestations devaient avant tout leur caractère militant et antisémite aux islamistes radicaux qui se sont implantés en Europe au cours des dernières décennies avec le soutien des Frères musulmans et l’argent de l’État qatari. Ceci principalement en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne, mais aussi en Suisse.
Depuis le 7 octobre, ces fanatiques religieux ne se contentent pas de vivre ouvertement leur potentiel de violence contre les juifs (et la police), mais ils ne font plus mystère de leur agenda islamiste fondamentaliste.
Pourtant, la menace qu’ils représentent à moyen et long terme pour nos sociétés démocratiques occidentales n’est pas prise au sérieux par les partis et les gouvernements établis en Europe. Au contraire, ceux qui mettent en garde contre cette menace sont taxés d' »islamophobie ».
C’est impardonnable. Car l’érosion de notre démocratie, que ces fanatiques islamistes peuvent pratiquer presque librement, n’est pas seulement dirigée contre les juifs et les autres minorités. Il nous concerne tous, et en particulier les femmes, qui sont des personnes de seconde classe aux yeux des islamistes. - L’antisémitisme violent est profondément ancré en Occident. Les islamistes qui défilent dans nos rues depuis deux ans ont enfoncé des portes ouvertes dans notre société en protestant contre les « sionistes », c’est-à-dire contre les juifs.
C’est ce qu’illustre la multiplication des agressions physiques contre les juifs et les institutions juives. Cela se voit dans les universités, où des étudiants d’extrême gauche hurlent avec enthousiasme des slogans antisémites, harcèlent et excluent leurs camarades juifs. Et cela se voit dans les médias sociaux et même dans leur propre environnement privé.
En ce sens, le 7 octobre a eu du bon : il a fait comprendre que l’antisémitisme n’est pas mort dans notre société et qu’il suffit de peu pour qu’il s’exprime à nouveau ouvertement et violemment. - Israël ne peut avoir confiance qu’en lui-même. Le comportement de la communauté internationale au cours des deux dernières années a montré qu’Israël ne peut faire confiance qu’à lui-même. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne l’Europe. Mais renforcer son indépendance est également un impératif stratégique du point de vue israélien vis-à-vis des États-Unis.
Certes, le plan de paix actuel, qui tient également compte des inquiétudes et des craintes d’Israël, est dû à l’administration américaine. Mais uniquement parce que le président américain s’appelle Donald Trump. Si la démocrate Kamala Harris était à sa place à la Maison Blanche, il n’y aurait pas sur la table un plan de paix en 20 points qui soit acceptable pour l’État juif. - Israël est à la croisée des chemins. Cependant, le conflit avec le Hamas n’a pas seulement montré la vulnérabilité de l’État juif face au terrorisme, à la guerre hybride, aux gouvernements occidentaux opportunistes et aux résultats des élections aux États-Unis.
Les deux dernières années ont également renforcé la fracture interne d’Israël. Le fossé profond traverse la société israélienne de deux manières.
D’une part, il divise les secteurs politiquement modérés de la population et les Israéliens de droite, voire d’extrême droite, qui rêvent d’un « Grand Israël » incluant la Cisjordanie et Gaza. Un rêve incompatible avec le plan de paix pour Gaza du président Trump, que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a clairement rejeté ces jours-ci à Washington.
D’autre part, les parties laïques de la société et les juifs ultra-orthodoxes s’opposent. Le débat sur le service militaire obligatoire montre à quel point cette opposition est fondamentale. Selon la décision de la Cour suprême, celle-ci s’applique également aux ultra-orthodoxes. Mais la plupart d’entre eux – pas tous ! – refusent de répondre à l’appel à l’armée.
Ce refus suscite à juste titre l’amertume de la grande majorité de la population laïque et des Israéliens nationaux-religieux qui, contrairement à la plupart des ultra-orthodoxes, effectuent leur service militaire. En effet, ils ont dû faire d’énormes sacrifices en tant que membres de l’armée au cours des deux dernières années.
Les partis ultranationalistes et ultra-orthodoxes ont certes un potentiel électoral limité en Israël. Ainsi, les deux partis des ministres d’extrême droite Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich ont obtenu moins de 11% des voix lors des dernières élections.
Même si l’on y ajoute les autres partis ultra-religieux et d’extrême droite représentés au Parlement israélien, la Knesset, la part totale de cet électorat est d’à peine 30% – comparable à celle des populistes de droite dans de nombreux pays européens.
Mais en raison de la forte fragmentation de la Knesset, les micropartis peuvent souvent y exercer une influence disproportionnée sur la formation et la politique du gouvernement en faisant pencher la balance du bon côté.
Des élections doivent avoir lieu en Israël dans un an au plus tard, en octobre 2026. On verra alors si l’État juif peut se libérer de l’emprise de ces groupes d’extrême droite et ultra-religieux. Sinon, le plus grand danger ne viendra pas de l’extérieur, mais de lui-même.
Ce rapport est également paru sur nebelspalter.ch
Sacha Wigdorovits est président de l’association Fokus Israel und Nahost, qui gère le site web fokusisrael.ch. Il a étudié l’histoire, la germanistique et la psychologie sociale à l’université de Zurich et a travaillé, entre autres, comme correspondant aux États-Unis pour la SonntagsZeitung, a été rédacteur en chef du BLICK et cofondateur du journal pour pendulaires 20minuten.
Vous avez rencontré un problème ?